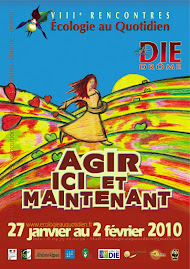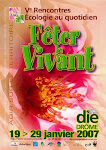ENVIRONNEMENT - Les retombées radioactives dans le voisinage direct de la centrale, devraient être plus importantes à Fukushima qu'à Tchernobyl. La biodiversité alentour risque d'être fortement impactée...
Sols, eau, végétaux, animaux... Si un
accident nucléaire comme celui en cours à
Fukushima libère des produits radioactifs dans l'atmosphère, c'est l'ensemble de l'environnement qui risque d'être contaminé.
Il est toutefois difficile d'évaluer le risque pour la centrale de
Fukushima car la contamination serait vraisemblablement différente de celle provoquée par l'explosion du réacteur de
Tchernobyl en 1986.
En Ukraine, la déflagration avait projeté des débris nucléaires à plus d'un kilomètre de haut et libéré un panache de particules et de gaz contaminés qui avait disséminé des éléments radioactifs sur la plupart des pays d'Europe.
Au Japon, les six réacteurs de la centrale sont à l'arrêt, et le risque d'explosion lié à un emballement de la réaction nucléaire semble écarté. Une contamination de l'environnement serait donc plus localisée, mais aussi plus forte.
«On s'attend à avoir des retombées plus importantes dans le voisinage immédiat de Fukushima que ce qu'on a eu dans le voisinage de Tchernobyl», explique à l'AFP Didier Champion, directeur de l’environnement à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire (IRSN). «L'inconvénient, c'est qu'on a un territoire qui est plus fortement contaminé à 10 ou 20 km, peut-être au-delà. L'avantage, par contre, ça veut dire moins de contamination à plus grande distance», ajoute-t-il.
LES PRINCIPALES SOURCES DE CONTAMINATION
Un
accident nucléaire peut libérer une grande variété d'éléments radioactifs, mais les deux principales sources de contamination sont l'iode-131 et le césium-137.
- L'iode-131
Ce produit de la fission nucléaire dans les réacteurs constitue le principal danger de contamination à court terme en cas de rejets dans l'atmosphère. Il se volatilise en vapeur violette à faible température, un peu au-dessus de 100 °C.
C'est un élément redouté car il est volatil et donc très mobile. Il se propage rapidement dans l'environnement: dispersion dans l'atmosphère, dépôt au sol ou sur les feuilles de végétaux, captation par les racines, ingestion par l'animal et éventuellement consommation par l'homme .Ingéré par les mammifères en période de lactation, l'iode se retrouve très rapidement dans le lait (quelques heures après l'ingestion).
Il se concentre dans la glande thyroïde, raison pour laquelle il est prévu de distribuer des pastilles d'iode stable en cas de contamination pour saturer cette glande et empêcher l'iode radioactif de s'y fixer. Contrepartie de sa grande radioactivité, l'iode-131 une vie très courte, la moitié de ses atomes se désintégrant naturellement en huit jours (période radioactive). Sa radioactivité est ainsi divisée par 2.000 tous les trimestres.
- Le césium-137
Cet élément, l'un des plus importants produits de la fission nucléaire, est la principale source de contamination de la chaîne alimentaire due aux essais nucléaires et à l'accident de
Tchernobyl.
Contrairement à l'iode-131, il est peu mobile et s'enfonce lentement dans le sol, où il est fixé par les minéraux. La contamination se fait d'abord par les feuilles, puis les racines. Les champignons et le gibier sont les plus contaminés par le césium. Il peut se concentrer dans la chaîne alimentaire, par exemple dans la chair des poissons.
Sa période radioactive est beaucoup plus longue que celle de l'iode-131 (30 ans) et il peut donc contaminer durablement l'environnement.
LES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA POPULATION
- L'alimentation humaine et animale
Selon Didier Champion, la priorité aux abords de la centrale est de surveiller «la contamination des denrées alimentaires» par dépôt des particules radioactives sur les feuilles, qu'il s'agisse des légumes consommés directement par la population, ou des végétaux consommés par le bétail. En raison de la rapide transmission de l'iode radioactive au lait, cette denrée fait également partie des «produits les plus sensibles dans l'immédiat».
Mercredi, l'UE a recommandé le contrôle des aliments importés du Japon.
- Les zones bâties
Que les éléments radioactifs contenus dans l'atmosphère retombent naturellement ou qu'ils soient lessivés par la pluie, ils peuvent former des dépôts dans les zones urbaines (routes, maisons, etc). «Le problème principal c'est que ces dépôts deviennent à nouveau une source de rayonnement, qui peut conduire à des doses durables», explique M. Champion.
- L'eau
Hormis les citernes d'eau de pluie, la contamination de l'eau reste a priori un enjeu «secondaire», selon l'expert de l'IRSN.
L'océan Pacifique voisin de la centrale constitue un « réservoir» où les produits radioactifs devraient se diluer. Concernant les rivières et aux autres sources d'eau potable, l'eau s'y écoule en permanence et le dépôt radioactif est rapidement évacué.
Quant à la nappe phréatique, il faut plusieurs années pour que la contamination migre dans le sol. Le césium-137 migre très peu et l'iode se désintègre bien avant d'avoir pu l'atteindre.